« – Mais comment tu fais pour être si intelligent ? – Je ne suis pas flic. »*
page 54, Les Jours de la peur de Loriano Macchiavelli
La position du critique debout est une zone critique mettant en avant un ou plusieurs livres de manière la plus franche possible sans souci d’y trouver, en retour, la moindre compensation si ce n’est celle que vous auriez en me disant que cela vous a donné envie de lire… ou vous aura éclairé pour ne pas le lire… FB

Aujourd’hui une rafraîchissante nouveauté nous venant tout droit de la gauche italienne bolognaise de 1974. Les Jours de la peur (Le piste dell’attentato) de Loriano Macchiavelli, traduit par Laurent Lombard, Les éditions du Chemin de fer (2024, 186 pages, 19€) est le premier épisode de la série du sergent Sarti Antonio, toujours en cours en Italie (? – le dernier date de 2022) dont quelques épisodes avaient été publié par Métailié, comme, par exemple, Bologne, ville à vendre (Cos’è accaduto alla signora perbene ?, traduit par L.L., 2006, 207 pages, 21€). Les Jours de la peur, attention, humour noir et engagement au programme !
« Tu as une nouvelle grande occasion en France. Ne la gâche pas avec une de tes crétineries. » (p.11)
Précédé d’une délicieuse lettre de son créateur à son personnage (pensez, cela fait déjà « cinquante ans que tu es là (…). Aujourd’hui s’ouvre pour toi une nouvelle opportunité en France, alors ne joue pas au con et essaie de faire en sorte que les lecteurs français t’apprécient à ta juste valeur (…).« ), Les Jours de la peur s’ouvre sur un attentat, celui du centre de transmission de l’armée à Bologne le 26 juillet 1978. La patrouille 28 est appelée mais le sergent Sarti Antonio est sur les gogues, la colite au cul et son collègue, Felice Cantoni (lui c’est l’ulcère) court le chercher. Ils arrivent à la bourre et mettent en place le barrage pour l’identification. Ils laissent passer Elle et Lui, « ils viennent juste de faire l’amour. Ça se voit aux yeux » (p.24) mais coursent une Fiat 128 noire avec, à bord trois zigues. Et c’est parti du feu de Dieu. « Je crois bien l’avoir déjà sorti ce truc du feu de Dieu. » (p.29)
On entre vite aux côtés de Sarti Antonio, d’autant plus que l’auteur nous fait entrer dans sa tête en lui prêtant des coups de gueule qu’il pense sans les prononcer, surtout ceux adressés à son inspecteur-chef Raimondi Cesare ou en s’adressant à lui comme il la fait dans la lettre d’ouverture du roman ou en apostrophant plus ou moins le lecteur sur un fait ou un geste de son héros : « Moi j’aurais directement attaqué par : « Tu étais où cette nuit vers 23h45 ? » Mais chacun sa méthode. » (p.35)
On sourit aussi des « gaffes » de Sarti Antonio, de sa ténacité dans l’affaire, de son parti pris envers Rosas, un gauchiste arrêté au profil coupable idéal à qui il achète des livres de Lénine et Maïakovski, toute honte non bue, pour qu’il ait de la lecture autre que les journaux centristes comme Le Corriere della Sera car « Les journaux, c’est une vaste saloperie. » (p.50), des foutaises écrites par son pote Lino Deoni, dit « Luciole« .
Il faut dire que le Sarti Antonio est bien entouré : il a Rosas donc, c’est presque son adjoint tant il souffle à l’oreille du flic : « il a » pourtant « une tête de niais à qui on donnerait pas un kopeck, et pourtant, quand il parle, tu te retrouves à l’écouter jusqu’au bout et tu te dis qu’il a raison. » (p.67). Il côtoie aussi Blondine la prostituée qui le nourrit parfois, passe ses nerfs sur le collègue qui conduit comme un fou et fume une cigarette par jour (« Saloperie d’ulcère. », p.141), Felice Cantoni et le journaliste Luciole, sorte d’enregistreur ambulant muet de preuves : » Tu viens avec moi et tu fermes ton clapet. Tu dois juste dire oui à chaque fois que je te le demanderai. » (p.145)
Ou comment se faire des lecteurs et des ennemis
Que ça fait du bien de lire cette prose drôle et incisive, intelligente et engagée, l’air de rien qui parle de tout, et surtout de « l’histoire d’une ville et, derrière elle, à peine voilée, [de tout] un pan de l’histoire italienne ». (p.10) Ça vaut le détour. Bologne comme tube à essai de la politique italienne, sa corruption, ses flics médiocres et ses voyous interlopes. Un précipité caustique et salvateur.
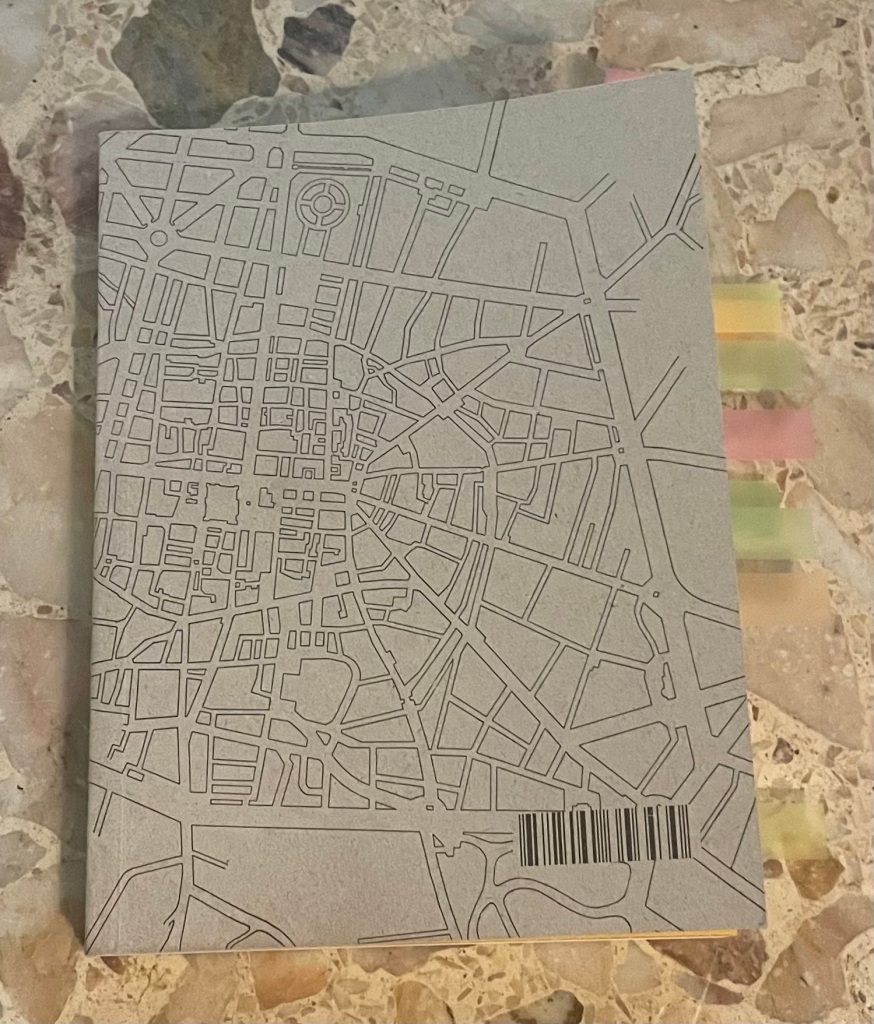
Loriano Macchiavelli, fondateur avec d’autres du Groupe 13*, nous parle de son entrée dans le noir en 1974 : « En Italie, le polar a souvent été snobé par la critique « intellectuelle ». Les militants de la gauche parlementaire ou extraparlementaire le regardaient avec méfiance dans les années soixante-dix et le considéraient comme étranger à la tradition italienne, comme une imitation américaine. C’est seulement à partir des années quatre-vingt que l’on commence à s’intéresser vraiment au polar. Lorsque j’ai écrit mon premier polar (années soixante-dix), mon ambition était de faire des romans qui puissent être lus par des ouvriers. Je venais du théâtre politique (Brecht) et voulais donc reproduire le même type d’engagement dans le polar. J’ai hésité à un certain moment, je pensais utiliser le roman d’amour qui pouvait être un moyen plus efficace de pénétrer le monde populaire et de faire passer des choses. Cette dimension politique de mes premiers romans est redécouverte aujourd’hui dans les postfaces des rééditions. Les ventes de Mondadori en 1974-75 étaient de l’ordre de 50 000 exemplaires. J’y ai donc vu un moyen privilégié de toucher un public plus vaste en racontant mes histoires qui, avec le théâtre, étaient réservées à une élite. Je pouvais continuer à développer mon regard critique sur la société. Étant de gauche, je l’appliquais à l’administration de la ville de Bologne qui était perçue alors comme le modèle de gestion des communistes. Je me suis fait de nombreux ennemis. »**
* Le « Groupe 13, fondé à Bologne par Loriano Macchiavelli, Carlo Lucarelli et Gianni Materazzo, et composé de dix autres auteurs débutants ou confirmés, tel Pino Caccuci, a signé le renouveau du polar italien » (source). ** Le polar italien : un genre qui a du mal à se faire reconnaître de Marco Oberti (extrait ici). Plus de polar italien ? On clique là.
Du plomb dans les années
La leçon finale (?), c’est Rosas qui la donne, dès la page 97 : « Va donc dire à ton inspecteur-chef et à ceux qui le manœuvrent qu’aucun de nous ne sort de chez lui pour aller tuer des soldats. Nous sortons juste pour leur expliquer qu’ils servent un État qui n’est pas à eux et que s’ils doivent tirer, il faudra que ce soit contre l’ennemi de tous : le capitalisme. » Des idées un peu comme ça, on sait où ça mène comme dirait l’extrême centre…
Les choses sont claires, non ? Comme un Nouveau Front Populaire… mais vous allez dire que j’exagère et qu’il ne faut pas mélanger la politique et la littérature…
François Braud
Papier écrit en écoutant Y a de la joie de Charles Trenet (1936). Ce titre, Les Jours de la peur, j’ai eu envie de le lire grâce à un collègue, Jean-Marc Laherrère d’Actu du noir. Merci à lui. Je l’ai acheté, le livre, dans une librairie. Le prochain, ce sera celui que j’ai retrouvé dans ma bibliothèque : Bologne ville à vendre qui commence (en 1979) par « Tout ce qu’ils écrivent est faux. » est précédé d’une avant-première postérieure (écrite en 2006) qui dit « Un roman, une fois publié, ne devrait plus être modifié. » Je ne sais pas vous, mais moi, ça m’interpelle ce genre de débuts… Je vous en reparle ? Papier recensé par bilbiosurf. Merci.
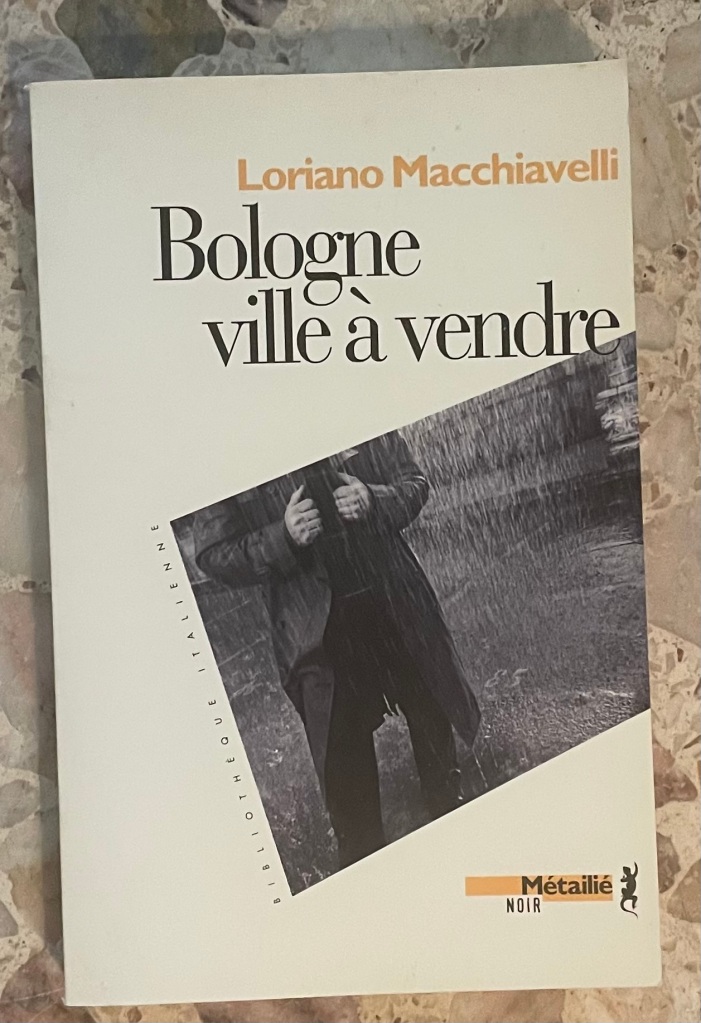
C’est chouette de voir à nouveau publier un nouveau roman noir de Loriano Macchiavelli
J’aimeJ’aime